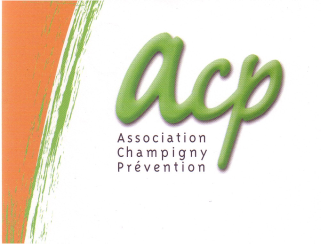Les principes de la prévention specialisée
L'absence de mandat nominatif est un principe fondamental qui engendre les autres principes. Il souligne l'importance de ne pas être mandaté par une décision de prise en charge émanant d'une autorité administrative ou judiciaire. Ce principe implique de recueillir l'adhésion de la personne avant d'envisager de travailler ensemble. La libre adhésion du public est une relation librement choisie, comme l'indique explicitement l'arrêté du 4 juillet 1972.
Chacun est libre d'adhérer, d'ignorer ou de refuser la relation éducative proposée par l'éducateur. Ce principe exprime la démarche "d'aller vers" en respectant le temps nécessaire à l'établissement d'une relation.
Le respect de l'anonymat est une action qui requiert discrétion et confidentialité, et qui assure au public qu'il n'y a aucune représentation personnalisée, telle qu'un dossier, à leur égard.
Ce principe découle directement des deux autres principes ; l'usager ayant la maîtrise du maintien ou non de la relation, l'anonymat lui offre une garantie supplémentaire.
Le partenariat est un principe qui s'inscrit dans le cadre des missions de la prévention spécialisée, car il n'est pas possible pour les éducateurs d'agir seuls. Ils doivent travailler en réseau et en complémentarité avec d'autres intervenants sociaux et professionnels. La non-institutionnalisation des actions est un principe essentiel de la prévention spécialisée. Elle peut être amenée à créer des réponses inexistantes dans le quartier où elle exerce. Ainsi, elle doit pouvoir s'adapter aux évolutions des difficultés d'un quartier et éviter la fixité et la rigidité d'un cadre institutionnel établi.
Si l'action se révèle pertinente et doit perdurer, car elle a répondu aux besoins préalablement constatés, un passage de relais avec d'autres institutions et partenaires de quartier devra être établi.
Organisation du travail en prévention spécialisée de rue
- Le travail de rue
Les éducateurs exercent une présence sociale et éducative dans tous les espaces formels et informels que les jeunes occupent. Cette présence doit être quotidienne : dans la rue, sur les quartiers, sur les lieux repérés de regroupements des jeunes, dans les gares, les terrains d’activités, aux alentours des établissements scolaires… Elle peut être ponctuelle sur les lieux de manifestations variées, activités sportives, culturelles, ludiques…
La présence régulière auprès des jeunes dans le quartier, le travail avec les partenaires du quartier, le contact avec les habitants, les commerçants, les gardiens ont un impact sur la vie du quartier.
- Le travail d’équipe
Sous l’impulsion du chef de service, les équipes éducatives mettent en œuvre des actions de prévention spécialisée, en tenant compte des différentes réalités de chaque territoire. Les équipes sont bien ancrées sur leur terrain d’intervention. Chacune doit posséder une réelle autonomie, être en parfaite cohésion, avoir un discours commun.
La vie de l’équipe est importante et riche d’échanges. Aucun éducateur ne doit être isolé. Les situations des jeunes font l’objet de discussions et les décisions prises sont concertées.
- Le binôme
Le travail en binôme est obligatoire durant les heures de travail rue, les permanences d'accueil, les chantiers éducatifs, les accompagnements ou encore lors des séjours. S'il y a une impossibilité de travailler à deux, cette éventualité s'étudie en réunion d'équipe ou exceptionnellement avec l'autorisation du chef de service.
Le travail en binôme permet d'éviter une trop grande implication dans la relation duelle, d'avoir un double regard garantissant une meilleure objectivité de par la complémentarité des éducateurs. Il est l'assurance d’une plus grande qualité et d'une plus grande justesse des décisions prises lors des interventions sur le terrain. C'est pourquoi, les binômes ne sont pas exclusifs. Chaque membre de l'équipe doit être en capacité de travailler avec tous ses collègues. Une attention sera portée sur le fait que les binômes soient tournants et qu'ils ne se construisent pas à partir des affinités entre les personnes.
De plus, le travail en binôme permet la continuité des accompagnements et des différents projets lorsque les éducateurs sont absents. Même s'il est possible de déterminer des binômes référents dans les suivis ou les actions mises en place, le travail d'équipe prime sur ces références. Ainsi, chaque membre de l'équipe doit être en capacité de remplacer son collègue dans une référence. Cela induit que le binôme se doit de partager toutes les informations recueillies avec l'ensemble de l'équipe.
- Les réunions
Ces réunions nous permettent d’officialiser les discussions que nous avons pu avoir en temps informels. Il arrive que les projets soient discutés en amont et finalisés en réunion autour de la table.
Les réunions de direction : Le directeur avec le chefs de service compose l’équipe de direction. Elle assure la mise en œuvre du projet de service et des orientations éducatives. L’équipe de direction a pour avantage la prise de décision de manière participative et concertée. Elle conduit une réflexion sur les dynamiques de changement, d’évolution, de qualité du travail et du service rendu aux usagers. Elle anime, coordonne, gère, régule, élabore des stratégies et des positionnements. Elle se réunit toutes les semaines avec à l’ordre du jour des informations générales, le travail et la dynamique des équipes, l’examen de dossiers et décisions à prendre.
Les réunions d’équipe : les réunions d’équipe sont hebdomadaires, elles ponctuent la semaine des éducateurs et sont incontournables. Elles permettent de se retrouver a effectif plein en étant encadré par le chef de service. La réunion d'équipe est un espace formel d'échange, de collaboration, de transmission des informations internes et externes au service entre les différents membres de l'équipe et la direction. Ils s’y organisent le temps de travail de l'équipe, son fonctionnement, les prévisions d'action. C’est le lieu où s’effectuent les retours des réunions partenariales, le bilan des actions éducatives réalisées ou l'élaboration de celles à venir, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Ces moments d'échange permettent aux éducateurs de prendre de la hauteur par rapport aux situations qu'ils rencontrent, de pousser l'analyse pour un meilleur accompagnement. Ainsi, la réunion d'équipe représente l'instance de décision collégiale où les stratégies éducatives s’élaborent.
Ce temps fort permet que la parole se libère, il constitue un espace de régulation entre les membres de l'équipe. Il est attendu que les salariés relatent les difficultés rencontrées sur le terrain, que ce soit avec un collègue, un partenaire ou un jeune afin que le travail auprès du public ne soit pas impacté. Ce lieu est fédérateur, favorise le langage commun et la cohésion d’équipe.
Les réunions d’analyse de pratiques : lors de ces temps, les éducateurs apportent leurs situations les plus délicates de par leur contenu, mais aussi du ressenti de l’éducateur. Nous pouvons parler de nos émotions et de ce qui a pu raisonner en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne, ce qui rend ces réunions uniques, car le professionnel et le personnel peuvent se confondre, et parler de ces ressenti peux parfois (voire souvent) amener à parler de soi.